« Y a-t-il encore à éduquer ? »
L’autorité éducative en tant que notion et que pratique a, semble-t-il, toujours fait l’objet de débats. Ce qui paraît nouveau, dit Coquoz, c’est « la confusion de notre époque sur cette difficile question » (2000, p. 12). Dans une préface intitulée « Les fondements introuvables de l’autorité éducative », il affirme que « l’on assiste à un lent bouleversement des rapports entre les générations et par conséquent à un renouvellement des conceptions de l’éducation » (Ibidem, p. 13). L’évitement dont le terme même d’autorité fait l’objet sert à « voiler la dimension hiérarchique et l’obéissance qui caractérisent la relation éducative » (Ibidem, p. 19). Dans un chapitre final intitulé « Que devient l’éducation ? », Coquoz pense que « les éducateurs doivent se préparer à cette idée que les statuts d’enfant et d’adulte tendent à s’égaliser et à modifier par conséquent les rapports entre les générations. Mais si cette perspective se précise, elle soulève évidemment quelques questions de fond. Y a-t-il encore à éduquer cet enfant s’il devient l’égal de l’adulte ? » (Ibidem, p. 35.)
Une pratique situationnelle et transversale de l’autorité
La réflexion qui suit est le fruit d’un échange entre les deux auteur·es. L’une des signataires a également interrogé de manière informelle ses collègues de travail, dont certains propos parsèment dès lors l’article. Nous sommes arrivé·es au constat d’une pratique de l’autorité qui tend à devenir situationnelle, suivant en cela l’évolution du travail social qui cherche à adapter son activité aux spécificités des situations vécues[1]. Nous rappelons seulement la perspective : toute situation éducative nécessite, outre des savoirs et des savoir-faire professionnels, une adaptation de l’activité professionnelle, en situation et en cours d’action, qui tienne compte des particularités contextuelles, y compris celles des usagers et des usagères. L’enjeu, on le devine, est de garder une cohérence et une clarté des principes généraux à l’œuvre, tout en les accordant aux réalités particulières imprévues, humaines et institutionnelles. Alors articulée à une situation dont les spécificités sont prises en compte, l’autorité ne peut plus être un concept rigide et entièrement prédéfini, auquel le réel (l’enfant) devra s’adapter quoi qu’il en coûte.
Tous les propos recueillis et nos propres observations amènent à cette constatation, qui n’a rien de surprenant en soi : l’autorité qui se pratique sur le terrain aujourd’hui cherche à s’adapter aux situations, aux individus, et à s’articuler plus étroitement à d’autres conceptions éducatives (participation, droits de l’enfant, éthique, responsabilité, etc.). Simultanément, et cela est assez logique également, cette façon de faire autorité, plus complexe et plus transversale à l’activité, ne veut pas être assimilée à la figure traditionnelle de l’autorité, dont les abus ne cessent d’être documentés depuis de nombreuses années.
Une tour de Babel
Mais reprenons les choses du début. Il y a quelques décennies déjà qu’un malaise profond qui rongerait notre société a été identifié et désigné d’une métaphore expressive : la perte des repères. Le renforcement des modalités individuelles d’existence, et l’affaiblissement proportionnel du recours aux modes collectifs de gestion de soi et de régulation des relations avec autrui, nous a conduit·es à une responsabilité isolée n’ayant d’autre recours qu’elle-même, engendrant ce qu’Ehrenberg a appelé La fatigue d’être soi (1999). Le constat est celui d’une identité se diluant dans sa propre liberté : être un individu individué, promulguant et développant ses propres normes, équivaut à être seul·e face aux aléas de l’existence, ce qui finit par devenir épuisant.
Cette perte de repères sociaux découlant de la régression de valeurs et de normes communes renvoie au concept de désorganisation sociale développé par l’école de sociologie de Chicago. Le désir et l’action de s’émanciper des carcans et des dominations collectives sont vus comme sources de dérèglement de l’ordre social. Les coûts sociaux de la liberté individuelle apparaissent ainsi supérieurs à ses bénéfices, puisque le gain personnel engendre une désorganisation collective dont chacun·e subit les effets négatifs.
Parmi les repères écartés ou perdus, il y en aurait un central, celui d’autorité. Cette centralité s’explique par le fait que l’autorité est une notion hyper-référençable, une idée sur laquelle tous les points de vue peuvent, voire doivent, s’exprimer, qu’ils soient pédago-éducatifs, politiques, philosophiques, sociologiques, économiques, psychanalytiques, etc. L’autorité en tant qu’idée est alors elle-même source d’une forme d’anomie, pour reprendre un terme sociologique, de désorganisation des relations sociales, tant elle génère de désaccords, de dissensions et d’antagonismes, même si, au départ, elle ne fait que les révéler.
Crise du débat sur l’autorité
La crise de l’autorité est donc telle de nos jours que la Revue [petite] enfance parle d’« effacement progressif et silencieux d’un concept-phare de l’éducation de l’enfance »[2]. Notons que, pour nuancer les choses, « plutôt que de crise, les philosophes préfèrent parler d’érosion, terme évoquant une transformation et une temporalité plus lente » (Robbes, 2014, p. 4). Cette idée de transformation lente nous intéresse, parce qu’elle rappelle que l’autorité, en tant que concept, reflète une réalité sociale qui se transforme progressivement.
Cet effacement progressif et silencieux du concept peut s’expliquer par deux problèmes particuliers que porte aujourd’hui la notion d’autorité éducative : la connotation négative (abus) dont elle est l’héritière et le pouvoir statutaire auquel elle renvoie. Les valeurs sociétales contemporaines étant théoriquement ancrées dans l’égalité, la participation, la justice sociale, etc., cela crée un décalage majeur avec les valeurs que porte et représente l’idée traditionnelle de l’autorité, au nom de laquelle une multitude de crimes et d’infractions ont été commis.
Remarquons au passage cette équivoque : l’autorité a toujours fait débat, mais ne provoquerait désormais plus de discussions, puisque nous évitons même d’utiliser le nom et la notion. La crise de l’autorité serait alors la crise du débat sur l’autorité. Le concept d’autorité dans sa version traditionnelle est tellement marqué de souffrances qu’il en est devenu le synonyme. Faut-il alors trouver un autre mot pour désigner cette dimension centrale de la relation éducative ? Ce n’est pas certain. Ce qui l’est par contre, c’est que la pratique de l’autorité éducative doit se réinventer et se redéfinir en évitant les tabous et les faux-semblants, et que les professionnel·les ont un rôle à jouer dans ce renouvellement : mais cela ne sera pas possible sans un vrai débat sur la question.
Dialoguer pour penser
Dans la formation de travailleur et de travailleuse social·e, on enseigne que les usagers et les usagères sont des expert·es et des acteurs·actrices de leur propre situation, et que les professionnel·les n’ont pas pour fonction de penser ce qui est bien ou non pour autrui, mais d’aider cet autrui à trouver son propre chemin. Ce qui est valorisé, c’est une relation aussi symétrique que possible entre professionnel·les et usagers·usagères. Où il y a souvent confusion, c’est qu’il ne s’agit pas et ne peut pas s’agir d’une égalité de statuts, mais d’une égale valeur des expertises respectives : ce qui change beaucoup de choses. Reconnaître l’égale valeur et la complémentarité de l’expertise usagère et de l’expertise professionnelle (Rullac, 2021) n’abolit pas la hiérarchie statutaire, mais cherche à faire dialoguer les compétences effectives de chaque partie sans s’abandonner aveuglément à la supériorité très relative qu’établissent les statuts.
Or, l’autorité ne se définit pas a priori comme un dialogue[3] : ce n’est pas le premier terme qui vient à l’esprit lorsqu’on l’évoque. L’exercice de l’autorité a cependant toujours un·e ou des destinataire·s, c’est donc une interaction par définition. La question est de savoir jusqu’à quel point cette interaction fait l’objet d’un dialogue, voire d’une transaction ? Une autre manière de poser la question serait de se demander ce qu’est une interaction sans dialogue ?
Une interrogation de fond qui réapparaît concerne la fonction de l’éducation entre autonomiser et socialiser, entre émanciper l’individu et perpétuer l’ordre social. Cette tension a été analysée par Coquoz également (1998), qui montre qu’elle ne peut être résolue définitivement qu’en versant dans le dogmatisme : se maintenir dans le paradoxe, maintenir en tension les opposés et les faire dialoguer, est la condition sine qua non pour penser son activité.
Ce que l’on observe dans les institutions de l’enfance, c’est-à-dire dans la pratique quotidienne des professionnel·les, c’est que le curseur entre ces deux pôles se déplace en fonction des valeurs institutionnelles et des projets pédagogiques, dans lesquels on valorise plus ou moins l’autonomie, la participation, la citoyenneté, l’intégration, la socialisation, etc. Autrement dit, entre autonomie (liberté) et socialisation (ordre, autorité), l’équilibre sera variable selon les lieux de pratique professionnelle et, bien sûr, selon les époques.
Cela nous amène au constat que l’autorité en tant que relation de pouvoir entre adultes et enfants continue bien de faire l’objet de réflexions et de pensée dans le champ de la pratique professionnelle, même si les discours semblent éviter prudemment la référence explicite aux conceptions traditionnelles de l’autorité.
Notons encore que la place grandissante des parents et de leurs conceptions éducatives dans les institutions influence les options possibles et celles retenues. Les parents sont porteurs de leurs propres représentations, mais aussi de théories issues d’une littérature qui leur est directement adressée et qui développe des conceptions telles que l’« éducation positive », ou qui leur propose d’apprendre à « éduquer son enfant sans punition », etc. A travers le dialogue entre professionnel·les et parents, la question de la pratique de l’autorité dépasse la dimension professionnelle et acquiert une dimension sociale. L’illusion d’une égalité statutaire entre enfants et adultes transportée par ces théories, maintient et conforte dans un angle mort la réelle relation de pouvoir et d’autorité qui existe pourtant, empêchant d’une certaine façon de parler et de débattre d’autorité éducative.
L’autorité est inévitable
En fait, « il n’y a pas une figure de l’autorité mais plusieurs. Et le vrai débat n’est pas entre une liberté et une autorité aussi abstraites l’une que l’autre, mais entre les différentes figures de l’autorité : laquelle est la plus apte à éduquer, c’est-à-dire à former la liberté ? Ce débat est celui entre les tenants de l’Education classique et ceux de l’Education nouvelle sous toutes ses formes. » (Reboul, 1989, chap. V.)
La démocratie repose essentiellement sur des valeurs d’égalité, et l’autorité étant par définition une relation asymétrique et donc inégalitaire, elle pose à l’Education classique un problème de fond, que Reboul expose ainsi : « Peut-on faire des êtres libres par des moyens contraignants, en leur imposant des modèles qu’ils n’ont pas choisis, une discipline qu’ils ne comprennent pas toujours, une évaluation qui n’est pas la leur ? De plus, cette thèse n’échappe pas au reproche d’élitisme. Depuis l’Antiquité jusqu’à nous, la culture “libérale” est réservée à une minorité, à ceux qui précisément sont appelés aux postes de commande. Elle forme moins des hommes libres que des chefs. » (Ibidem.)
C’est bien une forme précise d’autorité qui est en crise, et non le principe en soi. Reboul souligne d’ailleurs la malléabilité du concept selon les fins poursuivies. « L’Education nouvelle ne rejette pas toute forme d’autorité. Elle accepte celle de l’expert : le maître est en effet la “personne-ressource” qui vient en aide aux élèves et leur fournit les explications qu’ils demandent. Egalement celle de l’arbitre, lequel peut être soit le maître, soit le conseil de classe, soit des élèves élus par leurs pairs, mais qui reste indispensable du moment qu’il existe des conflits. (…) En quoi cette thèse s’oppose-t-elle à la précédente ? Pour l’essentiel, en ce qu’elle prétend remplacer l’autorité des modèles par celle du contrat. » (Ibidem.)
Modifier les contenus et les formes de l’autorité, atténuer l’expression de la relation asymétrique de pouvoir modifie la figure de l’autorité, la question qui se pose étant de savoir si à un radical changement de forme correspond un radical changement de fond ? « Bref, au nom de la liberté, on prétend ne garder qu’une obligation d’ordre contractuel et une autorité d’ordre fonctionnel. Toute la question est de savoir si c’est possible ou si l’on ne s’appuie pas, inconsciemment, sur des formes de l’autorité qu’on prétendait rejeter. » (Ibidem.)
La question faussement naïve de Reboul nous indique que l’autorité en tant que mot et que concept est un masque, que l’on transforme selon les époques et les contextes, mais que la façade égalitaire n’abolit pas l’asymétrie profonde caractérisant l’éducation. Reboul le dit à sa façon, dans un passage éloquent jetant une pierre dans le jardin des éducateurs et des éducatrices : « Que faire alors, si l’on ne veut pas recourir à la contrainte ? Ruser, manipuler, pour faire admettre aux élèves ce qu’ils doivent admettre, leur faire apprendre ce qu’ils n’ont pas envie d’apprendre. Ces ruses, ces manipulations n’ont rien de condamnables ; ces termes péjoratifs ne désignent en fait rien de moins que la pédagogie elle-même ! Mais celle-ci n’est plus légitimée puisqu’elle s’appuie, sans le dire, sur un type d’autorité dont elle ne voulait plus. » (Ibidem.)
Cette impossibilité de définir une autorité sur laquelle tout le monde serait d’accord est en fait emblématique d’une société démocratique, qui accepte et surtout discute la coexistence des différences. « En effet, une société vraiment démocratique se reconnaît d’abord à ceci qu’elle n’est pas vouée à une valeur, mais à plusieurs, qui peuvent être ou paraître incompatibles, mais qui en tout cas ne dépendent pas du pouvoir, qui n’a pas à “dire le sens”. Le rôle d’un Etat démocratique est tout au contraire de permettre à chacun de trouver par lui-même le sens de sa vie, en adulte. Un Etat n’est démocratique que s’il renonce à être une Eglise. » (Ibidem.)

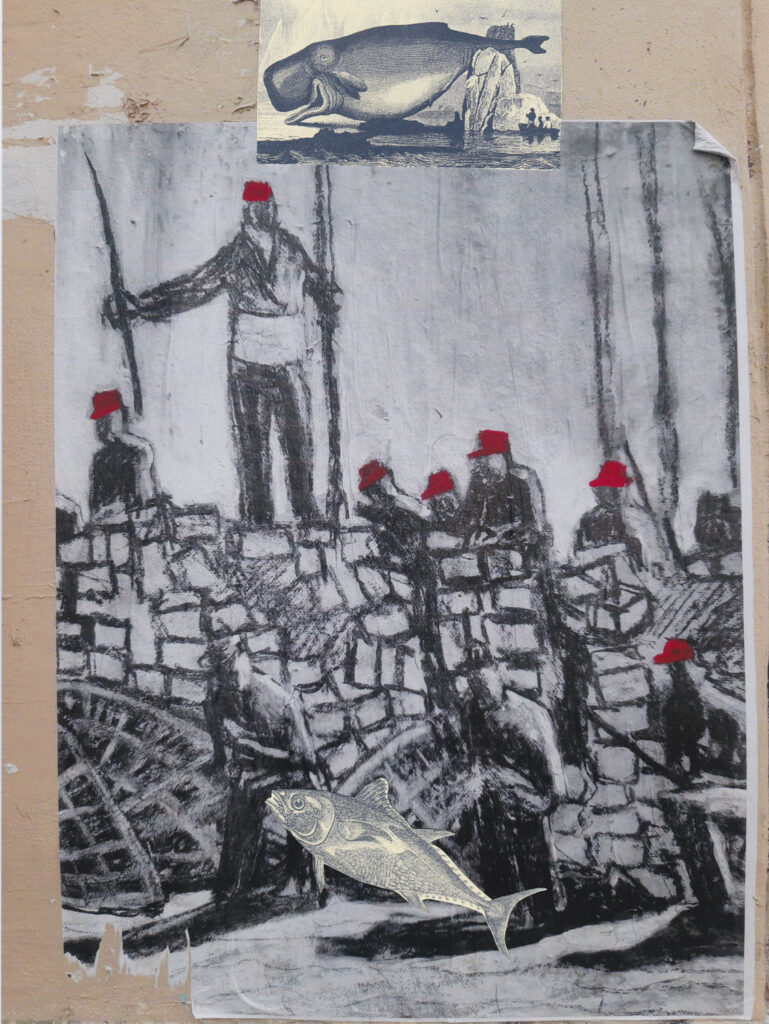
Les garant·es du cadre
Lorsque nous interrogeons des éducateurs et des éducatrices de l’enfance sur leur définition de l’autorité afin de percevoir les représentations à l’œuvre, c’est la notion d’« être garant·e du cadre » qui revient largement. Une éducatrice qui travaille avec des enfants de 1 à 2 ans dit : « L’autorité ? C’est pas vraiment un truc qu’on fait. » Une autre travaillant avec des enfants âgés de 3 à 12 mois complète en indiquant qu’effectivement, « cela dépend de l’âge ; l’autorité ne fait pas sens en nurserie ». Et enfin, une troisième expose que « l’autorité reflète la notion de pouvoir sur les enfants, notion avec laquelle je ne suis pas d’accord ». Confirmation, si besoin était, de la connotation négative qui accompagne le terme.
Dans les projets pédagogiques des institutions, nous retrouvons à foison les valeurs de respect, d’empathie, de solidarité, de participation de l’enfant, d’autonomie, etc. : mais il semble impossible de faire coexister dans le texte ces valeurs avec la notion d’autorité. Combien de projets pédagogiques aujourd’hui consacrent explicitement un chapitre à la question de l’autorité ?[4]
Pourtant, qu’on le veuille ou non, la relation asymétrique adulte-enfant existe par la force des choses : elle est incontournable. Aurions-nous alors un problème seulement avec le terme et la notion d’autorité, et non avec ce qu’elle représente dans la réalité des faits ? Car au fond, les adultes en général et les professionnel·les en particulier restent responsables des enfants qui leur sont confiés : ne devrait-on pas mettre en lien de manière plus claire autorité et responsabilité ? Et n’est-ce pas le glissement sémantique qui est suggéré lorsque les professionnel·les que nous avons rencontré·es parlent d’être avant tout des garant·es du cadre ? Le problème n’est pas résolu pour autant : de quel cadre ou de quel type de cadre parle-t-on ? Et que signifie, très concrètement, être garant·e ? La police et la justice, par exemple, sont aussi garantes d’un cadre.
L’inégalité et l’altérité
Nous insistons un peu lourdement sur ce point, car il nous paraît être le point de départ de tout débat qui se veut lucide sur la question : les professionnel·les de l’éducation ne peuvent faire l’impasse sur l’inégalité fondamentale dans laquelle ils et elles agissent, et sur le fait que l’éducation a lieu dans cette inégalité. L’éducation est une relation à autrui dans laquelle s’exerce un pouvoir, et les figures que prend l’exercice de ce pouvoir découlent des fins que nous imaginons pour autrui[5] et des moyens que nous mobilisons pour y parvenir. Nous pouvons schématiser l’activité éducative comme l’exercice d’un pouvoir sur autrui, et l’autorité comme la relation qui s’établit dans l’exercice de ce pouvoir. A défaut de pouvoir faire disparaître l’autorité et l’asymétrie, nous pouvons nous interroger sur la façon d’en user et de les (dé)construire.
Dans la société contemporaine et dans le champ de l’éducation professionnelle de l’enfance qui nous concerne, il semble inéluctable de redéfinir l’autorité et d’engager ouvertement le débat. Certains ne craignent pas de relever le défi : « Comment faire alors pour accueillir les valeurs démocratiques tout en maintenant la nécessaire dissymétrie statutaire et fonctionnelle, condition indispensable au travail éducatif ? Devant ce défi, il convient d’articuler la discipline (régulation des conduites et des comportements) et le droit (communauté des égaux, posant des limites à l’action des hommes). (…) C’est donc l’idée que la position d’autorité est nécessaire, mais aujourd’hui elle se construit, se travaille. Cette construction est sociale et personnelle. » (Robbes, 2014, p. 4.)
Robbes va plus loin et associe autorité et bienveillance : « Dans le même temps, il est nécessaire de renouer avec “l’autorité bénéfique”, davantage horizontale que verticale, construite sur la confiance et dans la cohérence, où les erreurs sont possibles mais reconnues. Cette autorité connaît l’importance du lien à préserver, oppose un “non” au “non” sans nier l’autre, sans l’abandonner. Elle apporte la protection, la sécurité, elle est un guide. C’est l’autorité de bon aloi, de “bonne veillance”. » (Ibidem, p. 6.)
Lorsque nous parlons d’autorité avec des éducateurs et des éducatrices de l’enfance, il est en effet une autre notion qui est régulièrement convoquée, celle de lien. Confirmant les dires de Robbes, ils et elles affirment que l’autorité n’est possible que si un lien positif a été créé au préalable avec les enfants auxquels elle s’appliquera. Et toujours dans le même sens, Nanchen (2002) distingue deux axes complémentaires dans l’éducation : l’axe normatif et l’axe affectif. L’enjeu ici est que l’autorité appliquée n’ait pas uniquement une légitimité statutaire, normative, mais qu’elle soit considérée comme légitime également par les enfants à qui elle est destinée, à travers le lien qui aura été construit et sur lequel elle va reposer.
Assumer la légèreté
Une éducatrice dit : « Nous devons accepter que l’autorité ne soit pas une marche à suivre ou une arme à enclencher au moindre “débordement”, mais plutôt un élément de la relation éducative qui se modèle suivant les contextes, les situations et les buts éducatifs. »
Il semble donc que les professionnel·les s’y retrouvent lorsqu’ils et elles parlent des pratiques professionnelles nécessaires pour tenir le cadre, notamment à travers des règles et des limites établies en équipe. Ce qui semble manquer singulièrement, c’est le débat sur les axes et les modalités d’application, chacun·e y allant de son instinct ou des connexions qu’il ou elle aura faites entre ses différentes connaissances théoriques et personnelles des enfants.
Ce qui en tous les cas semble avoir du sens pour la pratique professionnelle, c’est une conception variable et hybride de l’autorité, adaptée aux circonstances et aux situations. Une éducatrice explique ainsi que « dans le groupe des 3-4 ans où je travaille, nous avons conceptualisé les règles en deux catégories, les règles rouges : obligatoires et indiscutables pour tous et toutes (surtout par rapport à la sécurité physique), et les règles vertes qui sont modulables et contextuelles. Par exemple, on a le droit de monter sur les tables à certains moments, ou on a le droit de courir sauf lors des repas, les temps de repos et autres contextes. Nous ne les nommons pas ainsi aux enfants, mais c’est clair entre nous quelles règles sont dans quelle catégorie. »
« La pédagogie a longtemps cherché à fonder son discours en vérité et à établir des prescriptions à caractère scientifique. Il lui faut maintenant assumer son insoutenable légèreté et en tirer toutes les conséquences : placer l’inventivité et la formation du jugement au cœur de sa démarche ; accepter la béance irréductible entre le dire et le faire. » (Meirieu, 1995, chap. 7.)
Les mots de Meirieu nous semblent particulièrement valables pour ce qui concerne l’autorité. Le problème que l’on devine étant celui de l’absence de définition de ce que serait « la bonne autorité », cette absence créant une incertitude, un vide qu’il revient aux professionnel·les de combler. Or, et c’est là que le bât blesse selon nous, il est devenu compliqué de parler sereinement d’autorité dans l’éducation de l’enfance pour les raisons déjà évoquées. Il ne sera pourtant pas possible de rénover les conceptions et les pratiques de l’autorité sans en parler, sans en faire un débat résolument ancré dans les valeurs actuelles de l’éducation, tout à fait compatibles avec une relation éducative dans laquelle les adultes exercent bien un pouvoir et une responsabilité.
L’aspiration que l’on devine chez les professionnel·les, c’est que l’autorité ne soit pas un principe surplombant que l’on vient inscrire dans une réalité comme la foudre tombant du ciel, mais que ce soit une construction concrète dans la rencontre avec autrui, obéissant à certains principes plus ou moins négociables.
Dans « la béance irréductible entre le dire et le faire » dont parle Meirieu, le « faire autorité » s’est trop longtemps réduit à « dire l’autorité », avec une réussite tellement relative que l’on a préféré abandonner l’idée même d’autorité, plutôt que de convoquer l’autre pôle, celui du faire, de l’activité professionnelle, pour lui donner une forme complexe plus adaptée.
Alors, l’autorité, qu’est-elle devenue ? Nous répondrions qu’elle poursuit sa mue dans le champ professionnel de l’éducation de l’enfance. Sa conception traditionnelle de principe surplombant et indiscutable est toujours présente et à l’œuvre d’une certaine manière, mais nous voyons se développer des formes d’autorité qui, pour se construire, s’appuient moins sur des normes morales ou des dogmes, et s’inscrivent prioritairement dans une perspective d’activité éthique en situation.
Il nous semble qu’il y a surtout un déficit majeur de débat à ce sujet entre professionnel·les, puisque ce sont bien elles et eux qui, jour après jour et quoi qu’il en soit, assument une responsabilité éducative en faisant usage de pouvoir, dans une relation qui reste en fin de compte tout empreinte d’autorité. Ce manque de débat est à mettre en lien avec la « confusion de notre époque sur cette difficile question » dont parle Coquoz (2000, p. 12) : cette confusion est comme inhibitrice (plus personne ne sait à quelle autorité se vouer, ou ce qu’il est bienvenu/malvenu de dire et de faire), et simultanément, l’absence de débat au niveau professionnel ne fait qu’augmenter et renforcer cette confusion.
Combler le vide
L’une des conséquences de cette indéfinition de l’autorité éducative aujourd’hui, concerne la transmission des savoirs et des savoir-faire aux futur·es professionnel·les ainsi qu’aux personnes non formées travaillant dans les institutions de l’enfance[6]. Les professionnel·les formé·es ont la responsabilité de transmettre des savoirs et des savoir-faire aux novices (stagiaires, auxiliaires, etc.). Comment faire cela, lorsqu’on n’est soi-même pas au clair sur la définition et l’application professionnelle de l’autorité éducative ?
Un large débat professionnel, lucide et exigeant, sur ce sujet qui affecte toute la relation éducative, l’autorité étant probablement l’élément central autour duquel toute forme d’éducation se définit et se pratique, se présente comme un vide à combler. C’est une possibilité que les professionnel·les de l’éducation de l’enfance peuvent saisir, pour affirmer une expertise et une vision sensée de l’éducation et de l’autorité.
Amélie Besse et Robert Frund
Bibliographie
Coenen-Huther, Jacques (2005), « Pouvoir, autorité, légitimité », Revue européenne des sciences sociales [En ligne], XLIII-131 | 2005, mis en ligne le 12 novembre 2009, consulté le 30 janvier 2023. https ://journals.openedition.org/ress/471
Coquoz, Joseph (2000), « Préface – Les fondements introuvables de l’autorité éducative », In Châtelain, Sylvie (2000), Règles, éducation et obéissance, Les Cahiers de l’EESP, Lausanne.
Ehrenberg, Alain (1999), La fatigue d’être soi, Odile Jacob, Paris.
Mayen, Patrick (2004), « Le couple situation-activité, sa mise en œuvre dans l’analyse du travail en didactique professionnelle », Recherches contextualisées en éducation, N° 6, pp. 13-27.
Meirieu, Philippe (1995), La pédagogie entre le dire et le faire, ESF, Paris.
Nanchen, Maurice (2002), Ce qui fait grandir l’enfant. Affectif et normatif, les deux axes de l’éducation. Ed. Saint Augustin, Saint-Maurice.
Pastré, Pierre (1999), « La conceptualisation dans l’action : bilan et nouvelles perspectives », Education permanente, N° 139, pp. 13-36.
Reboul, Olivier (1989), La philosophie de l’Education, PUF, Paris.
Robbes, Bruno (2014), « L’autorité éducative, la construire et l’exercer. » SCEREN/CRDP. Fiche de lecture – S. Lacan.
https ://creg.ac-versailles.fr/IMG/pdf/fiche_de_lecture_l_autorite_educative_b._robbes.pdf
Rullac, Stéphane (2021), « D’usager·e à expert·e : le travail social en mutation », Reiso : revue d’information sociale. https ://www.reiso.org/document/7735
[1]-En résumé, l’engagement dans une situation éducative, selon Pastré (1999), confronte les professionnel·les à trois dimensions : la complexité, l’incertitude, l’interactivité. Et selon Mayen (2004), toute situation de travail se caractérise par trois propriétés : la diversité, la variabilité, l’extensivité. Nous imaginons aisément la complexité réelle que ces définitions et leurs éléments constitutifs engendrent (autorité et complexité + autorité et incertitude + autorité et interactivité + autorité et diversité + autorité et variabilité + autorité et extensivité), si on les applique à la pratique de l’autorité éducative.
[2]-Quatrième de couverture de ce numéro.
[3]-Sur le dialogue, et notamment le dialogisme selon Bakhtine, cf. les travaux d’Yves Clot et de l’équipe de la clinique de l’activité du CNAM (Conservatoire national des arts et métiers, Paris). Clot (1999).
[4]-C’est une vraie question.
[5]-Nous savons qu’avec les enfants, ces fins se regroupent sous l’expression générique de bien de l’enfant. Nous voulons tous et toutes, toujours, le bien de l’enfant ; le problème étant que nous ne sommes d’accord ni sur ce qui le constitue, ni sur les moyens d’y parvenir.
[6]-Les auxiliaires par exemple, non diplômé·es en éducation de l’enfance ou en travail social, sont engagé·es uniquement sur la base de leur expérience avec les enfants, parentalité y compris.
![Revue [petite] enfance](https://revuepetiteenfance.ch/wp-content/uploads/2022/12/revue_petite_enfance-302x103.png)