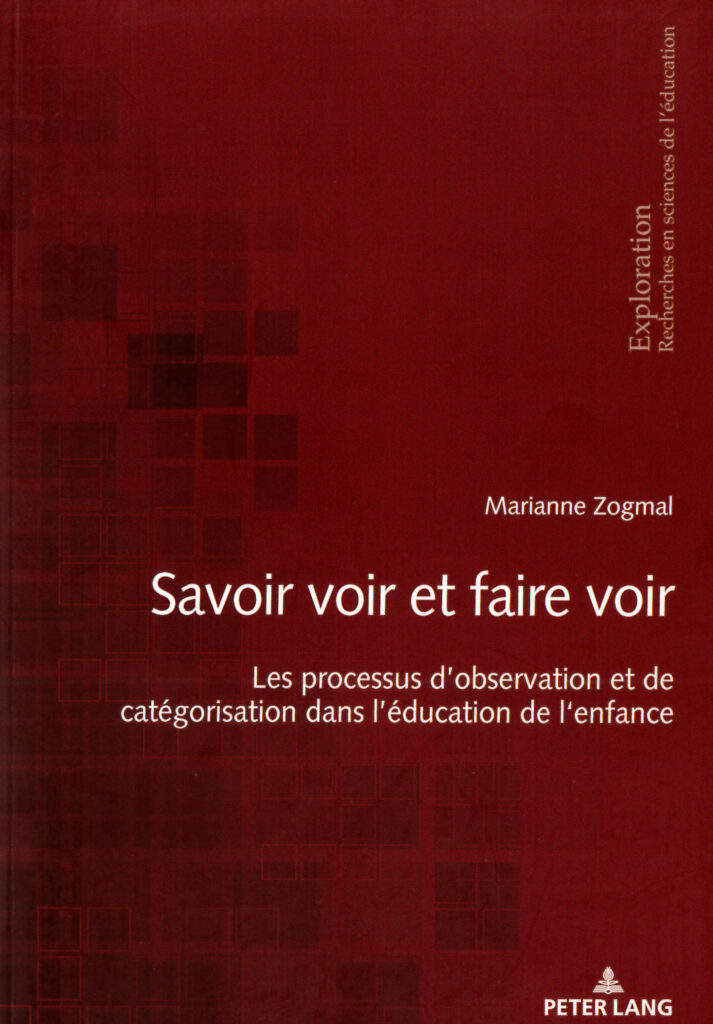Imaginons un∙e visiteur·euse, qui pénètre pour la première fois dans un lieu d’accueil de la petite enfance. Que voit-il·elle ? Il·elle entre dans une salle, deux adultes sont assises sur le sol, une dizaine de très jeunes enfants envahissent l’espace. L’un est assis sur les genoux de l’une des deux femmes. Une autre est occupée à fouiller dans une caisse, juste à côté. Deux enfants gravissent quelques marches en bois pour se laisser ensuite glisser sur un plan incliné, un troisième les regarde, une fillette frappe le sol avec une spatule. Deux bébés sont installés dans un parc et jouent à manipuler, qui un morceau de tissu, qui un bol en plastique. On entend des pleurs dans la salle d’à côté et l’une des éducatrices se lève pour aller chercher l’enfant qui vient de se réveiller. [1][2]
Ce travail paraît simple à ses yeux naïfs. Il n’y a pas de programme à suivre, rien à enseigner à ces enfants. Les adultes semblent « ne rien faire » ou si peu : elles échangent quelques mots entre elles ou avec un enfant, elles effectuent des tâches simples comme se lever, peut-être pour aller chercher un mouchoir et, après un bref échange avec l’un des petits, lui moucher le nez, ou remettre un semblant d’ordre dans les objets éparpillés par le jeu des enfants.
Tout au plus, cet∙te observateur·trice va-t-il·elle se dire qu’il faut de la patience lorsqu’il·elle assistera à une scène lors de laquelle l’adulte négocie longuement avec un enfant qui ne veut pas l’accompagner à la table de change, ou lorsque l’atmosphère devient houleuse : Karine a tapé sur la tête d’Alexandre, qui pleure. Du coup, Yodi se met à pleurer aussi. C’est le moment où Sébastien décide de renverser le contenu d’une caisse qui se répand avec fracas sur le sol…
Le paradoxe de ce travail est d’être d’autant plus invisible qu’il est bien fait. La scène est celle de l’enfant. L’adulte doit œuvrer en coulisse.
Zogmal, dans cet ouvrage, Savoir voir et faire voir s’intéresse à ce travail discret et l’analyse minutieusement. Il en ressort une image bien plus complexe, avec ses parts d’ombre bien sûr, mais aussi une mise en lumière de la manière dont s’y prennent, sans en avoir pleinement conscience, les professionnelles pour comprendre ce qui se joue et adapter leur action, ou pour agir et, tout en même temps, donner du sens à l’interaction en cours. Tant il est vrai qu’« il n’y a qu’un monde, c’est celui du désordre de faire et penser, de l’intrication irréductible de l’action et de la compréhension »[3]. L’auteure met ainsi en valeur ce travail, montre qu’il ne s’agit pas juste de moucher un nez, ramasser une petite voiture ou hausser la voix pour obtenir l’obéissance d’un enfant. J’aimerais revenir sur quelques éléments développés dans cet ouvrage, ceux qui m’ont frappée lors de ma lecture, sans prétendre en faire le tour, car il est dense et aborde de nombreux aspects de la banalité du travail quotidien dans les lieux d’accueil de l’enfance.
L’auteure rappelle les différentes visions de l’enfant qui ont traversé l’histoire. De « tube digestif », l’enfant est devenu une personne qui a le droit d’être considérée, de donner son avis, de participer. Ce n’est plus seulement un objet de soins, que l’on manipule au gré des besoins des adultes, mais un sujet à part entière. La gageure pour les institutions de la petite enfance est qu’il s’agit d’accueillir dans un collectif des enfants qui n’ont pas encore acquis tous les moyens pour exprimer clairement leur avis et leurs besoins, ni pour interagir de manière coordonnée avec leurs camarades. Des enfants qui sont encore largement dépendants des adultes pour les gestes du quotidien. « Pour chercher à le comprendre, il s’agit d’observer attentivement ses conduites, d’écouter ses mots. La différence de l’enfant exige des processus d’adaptation et une décentration de la part de l’adulte, afin de favoriser leur (sic) participation à la vie en société » (p. 11). Zogmal met en visibilité le travail effectué en arrière-plan pour que cette mécanique fonctionne. Elle met en évidence que le travail avec de jeunes enfants ne se construit pas avec des procédures toutes prêtes ou des « bonnes pratiques », mais se joue dans l’interaction ici et maintenant entre éducatrices et enfants, et dans les espaces d’élaboration en équipe. Elle souligne que cela nécessite du temps et un intérêt curieux pour les enfants. En effectuant ses observations durant des moments où éducatrice et stagiaire agissent ensemble et durant des entretiens de stage, elle démontre que cela s’apprend.
Contrairement à ce qui se dit au café du commerce (et dans certains colloques d’équipes éducatives malheureusement), il ne s’agit pas de « bon sens » ni d’« intuition », venus d’on ne sait où (du ciel ? des aptitudes naturelles de la femme ?). Mais, comme le montre l’auteure, cela implique de construire des connaissances sur chaque enfant, en articulant observation et catégorisation afin de pouvoir attribuer des significations à ses conduites. De plus, ces connaissances doivent être partagées dans l’équipe pour que l’enfant ne vive pas des pratiques incohérentes qui se modifient au gré des idées personnelles de chaque intervenante.
Marianne Zogmal met en évidence de manière fine les minicomportements des éducatrices qui vont leur permettre de s’ajuster aux enfants. Ces ajustements passent par l’usage du corps (gestes, mouvements, mimiques), par des mots et des intonations. Par exemple, lorsqu’une professionnelle décrit ce qu’elle voit à voix haute, elle rend perceptible pour l’enfant sa présence attentive et intéressée. L’auteure donne plusieurs exemples où l’adulte va proposer une interprétation en réponse à un comportement de l’enfant, mais elle va le faire avec une voix interrogative, ou en ménageant un espace temporel qui laisse une place à l’enfant pour manifester son accord ou son désaccord. Ainsi, malgré l’asymétrie des acteurs·trices, un dialogue se construit dans lequel l’enfant peut prendre place. L’une des scènes présentées montre une petite fille, SIR[4], qui s’est mise debout en s’accrochant à une barrière. Après un moment dans cette position, elle émet des vocalises qui attirent l’attention de l’éducatrice et de la stagiaire présentes. Va s’ensuivre un travail d’échange entre les deux adultes, d’« enquête » pourrait-on dire, afin de comprendre ce que veut l’enfant. Cet échange rend manifeste par la formulation des phrases que, peut-être, cette enfant demande de l’aide pour s’asseoir, mais que cette compréhension demeure incertaine et qu’il convient de vérifier. « La stagiaire s’approche de SIR et lui propose sa main (…). Elle observe ensuite SIR qui retire sa main. Ceci est catégorisé comme un refus de SIR. Ensuite par un mouvement, SIR rend manifeste qu’elle cherche à s’abaisser. La stagiaire fait alors la proposition de soutenir SIR en la tenant sous les bras. Son geste de soutien est accompagné par “ regarde, je peux t’aider ” (…). SIR s’appuie sur les mains de la stagiaire et s’assied avec son aide, ce qui est ratifié par la stagiaire. La conduite de SIR montre qu’elle ne cherche pas à donner la main pour s’asseoir, mais qu’elle sollicite un soutien quand elle s’abaisse. SIR participe activement à l’interaction. Elle l’initie, refuse la première proposition de la stagiaire et montre, par le mouvement de son corps, qu’elle cherche à s’abaisser. La deuxième proposition de la stagiaire est alors acceptée par SIR. Quand la stagiaire annonce la clôture de ce mouvement de s’asseoir et regarde SIR, l’enfant y répond par le sourire. » (p. 118).
Entre saisir cette petite fille et l’asseoir au sol comme un objet, ou la laisser se débrouiller toute seule au nom de l’autonomie, la stagiaire, dans cet extrait, prend le temps de vérifier son interprétation en faisant des propositions gestuelles appuyées par quelques éléments verbaux. Elle est attentive aux réactions de l’enfant et s’ajuste à celles-ci en modifiant sa proposition initiale. De cette manière, elle considère SIR comme une interlocutrice, une partenaire dans la relation.
Par ailleurs, Zogmal met aussi en évidence que les éducatrices utilisent ces phénomènes d’ostension pour construire le vivre ensemble. Plutôt que d’imposer aux enfants, par l’autorité, un déroulé des événements, les professionnelles cherchent à construire un monde « allant de soi » en favorisant l’attention conjointe et en soutenant la réciprocité des points de vue (p. 197). Ces pratiques permettent aussi aux éducatrices de se coordonner entre elles en rendant visible vers quoi elles portent leur attention.
Si l’auteure rend ses lettres de noblesse à ce métier, elle n’en cache pas non plus les errances et les difficultés. Parfois, l’image qu’une éducatrice s’est construite de l’enfant s’est cristallisée et l’empêche de voir ses avancées, ou ses autres compétences. Nous savons toutes le risque de coller des étiquettes aux enfants. D’autres fois, les interprétations des adultes vont s’appuyer sur des stéréotypes. L’auteure donne un exemple que je trouve parlant : lors d’un jeu auquel la stagiaire participe de façon ludique, les comportements des garçons sont systématiquement interprétés comme relevant de l’attaque, tandis que ceux des filles le sont comme des gestes de protection. Ainsi l’adulte pousse sans en avoir conscience les enfants à correspondre aux attendus de genre : aux garçons l’agressivité, la compétitivité, aux filles le care, la sollicitude (pp. 155-158). Nous autres, adultes, avons grandi dans un monde binaire, nous nous sommes construit∙e∙s sur ces catégories de genre, elles nous habitent ; nous y sommes tellement englué∙e∙s qu’il nous est très difficile de nous rendre compte que nous les perpétuons. Les équipes éducatives ont pourtant souvent l’impression d’être attentives à cette question. De plus en plus d’institutions ont trié leur matériel, retiré ce qui était trop ouvertement genré. Nous n’en sommes plus à mettre des étiquettes roses aux casiers des filles, ou à refuser d’enfiler une robe flamenco de la caisse de déguisements à un garçon. Mais ces éléments ne sont que la pointe de l’iceberg, et il reste fort difficile de nous rendre compte par nous-mêmes que nos attitudes, nos mots, nos attentes sont toujours différents envers les filles et les garçons. Je crois que c’est un travail impossible à faire seule. Lire cet exemple m’a amenée à repenser à un article de Karina Kühni dans cette revue[5], qui imaginait un lieu, l’ « élaboratoire », qui conjuguerait accueil des jeunes enfants, recherche et formation. Il y a là une voie féconde à mon avis pour donner les moyens aux professionnelles de développer la qualité de leur travail. Même si cette belle utopie n’existe pas encore, il me semble que la recherche de Zogmal, effectuée dans un lieu d’accueil de la petite enfance, par une chercheuse qui est aussi une professionnelle dudit domaine, est un premier pas dans cette direction, en diminuant peut-être l’effet de surplomb et d’extériorité des recherches traditionnelles (Kühni, op. cit., p. 115).
Pour terminer, ce livre a encore une autre qualité que j’aimerais relever, c’est celle de mettre en évidence l’importance de la « dispute professionnelle »[6]. En effet, l’auteure montre que travailler auprès de jeunes enfants nécessite de construire des connaissances à propos de chaque enfant sur lesquelles s’appuyer pour interpréter son comportement. « Une vigilance incessante, une faculté de “ voir ” les intentions, les besoins et les compétences des enfants donnent l’accès à une efficience des pratiques et à l’ajustement à chaque enfant » (p. 206). C’est ce qui se passe lors de l’accueil du matin par exemple. Les éducatrices vont aménager la situation en fonction de ce qu’elles connaissent de chaque enfant : Mélanie entre toujours gaillardement dans le groupe et file jouer sans se retourner pendant que sa maman transmet les informations, mais Patrick a besoin de passer de bras en bras, et de rester lové sur le corps de l’éducatrice encore quelques instants après le départ de sa maman. Si Sam arrive à ce moment-là, ça va devenir chaud, car lui aussi a besoin d’être accompagné, mais souvent, si on lui propose une grande chaise pour grimper dessus et voir disparaître son papa au bout du couloir après force bisous lancés au loin, cela marche mieux. Il en est ainsi toute la journée. Les éducatrices savent que si Sophie se tire l’oreille, c’est probablement qu’elle est fatiguée et que, lorsque Laurent ne veut plus suivre la vie du groupe, l’humour fonctionne mieux que d’élever la voix. Si Stéphanie ne fait que se disputer avec ses camarades, elle qui est d’ordinaire plutôt joyeuse et toujours partante, cela éveille leur attention. Mais ces savoirs sont partiels et fugaces. « Savoir répondre à un enfant nécessite de se positionner, de s’appuyer sur ses certitudes. Savoir l’écouter nécessite de s’interroger, de laisser la place à ses incertitudes et de tenir compte de l’aspect hypothétique des “connaissances” élaborées » (p. 207). La particularité de ce travail d’éducatrice de l’enfance est qu’il s’agit, simultanément, de percevoir, faire et penser. Il n’est pas possible, face à une situation, de dire aux enfants : « Stop ! Arrêtez-vous, je vais réfléchir et je reviens ensuite vers vous. » Par contre, on peut toujours revenir sur les situations après coup, on peut partager nos observations, nos hypothèses avec les collègues, on peut complexifier l’image qu’on s’est construite de l’enfant, on peut exprimer la fatigue ressentie face aux crises de Robin et le besoin de passer le relais, on peut écouter comment la collègue s’y prend, décider ensemble d’observer plus attentivement les moments où Robin va bien, etc. Comme le dit Zogmal, « ce sont les contradictions, les différences de niveaux de pensée, qui, à travers leur énonciation, peuvent participer à rendre visible l’aspect partiel et transitoire des observations et des catégorisations effectuées. Ainsi, les connaissances élaborées dans une équipe éducative peuvent être débattues, ce qui permet de les modifier et de les enrichir dans un processus collectif » (pp. 207-208). C’est ainsi qu’on évitera autant que possible d’enfermer les enfants dans l’image qu’on s’est construite d’eux. Il s’agit donc non seulement de « savoir voir » mais aussi de « savoir dire ». Zogmal note d’ailleurs les risques des non-dits. A trop vouloir éviter de stigmatiser les enfants, les éducatrices renoncent à mettre en mots les comportements récurrents de certains d’entre eux, pourtant vécus comme non légitimes (gestes agressifs, résistances, etc.). Pourtant, l’auteure nous rappelle que les processus de catégorisation font partie de notre fonctionnement humain et que ne pas les nommer ne les empêche pas d’exister. « Le risque subsiste que des catégorisations innommées restent impensées et engluées dans les émotions et dans l’agir » (p. 204), alors que le travail de pensée collective peut permettre la prise de distance nécessaire.
A l’heure où se développe l’attrait pour des méthodes pédagogiques, des « kits émotions » ou autres gadgets néolibéraux, cet ouvrage va à contre-courant en montrant que la pratique se joue d’abord dans l’interaction et la rencontre, qu’elle se construit par l’observation attentive et curieuse portée à l’enfant, et qu’elle est toujours à requestionner, remettre sur le métier. L’auteure met aussi en évidence le rôle important des collectifs de travail[7], si fragilisés aujourd’hui, pour soutenir cette activité d’élaboration du métier. Un travail exigeant : c’est le prix à payer si l’on veut réellement reconnaître l’enfant comme sujet.
Par Michelle Fracheboud, conseillère pédagogique
[1]-Malgré l’usage habituel dans la revue d’épicéniser le propos, j’ai choisi de suivre le parti pris de l’auteure et d’utiliser le féminin lorsque je parle des professionnelles travaillant dans les institutions. En effet, toutes celles dont les actions ont été retranscrites dans cet ouvrage sont des femmes (qui composent encore 96% des équipes, comme le relève Zogmal dans l’introduction [p. 1]).
[2]-Zogmal, Marianne (2020), Savoir voir et faire voir, Peter Lang, Berne.
[3]-Kühni, Jacques (2014), « Le plan et la stratégie ne sont pas les pères et mères de l’action », in Meyer, Gil et Spack, Annelyse (dir.), Accueil de la petite enfance : comprendre pour agir, Erès, Toulouse, p. 56.
[4]-Il s’agit bien évidemment d’une abréviation du prénom de l’enfant, utilisée par l’auteure lors de sa recherche afin d’anonymiser les enfants observés.
[5]-Kühni, Karina (2012), « L’élaboratoire, une utopie nécessaire », Revue [petite] enfance, N°109, pp. 111-116.
[6]-Au sens que lui donne Yves Clot, voire par exemple Clot, Yves (2010), Le travail à cœur, la Découverte, Paris ; ou encore Kühni, Karina (2011), « Le jugement du travail et la coopération », Revue [petite] enfance, N° 105, pp. 62-70.
[7]-Voir par exemple à ce sujet le dossier de la Revue [petite] enfance, N°131 (2020), « De quoi est fait un collectif de travail ».
![Revue [petite] enfance](https://revuepetiteenfance.ch/wp-content/uploads/2022/12/revue_petite_enfance-302x103.png)