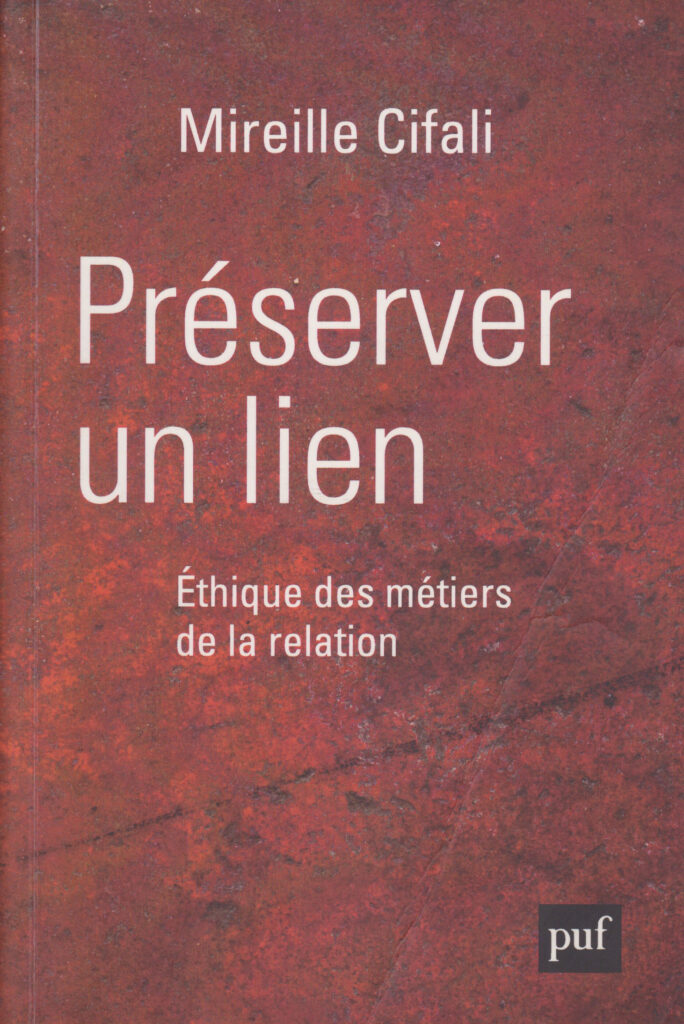En lisant Préserver un lien (2019)[1]
La notion de lien dans les métiers de la relation est récurrente, omniprésente. Le lien est dans toutes les bouches, il revient dans tous les colloques. Il est souvent décrit comme un des socles à partir duquel on commence à travailler pour de vrai, au risque de travailler un peu mieux, voire à faire du bon travail. Dès lors, la question et la visée éthique de celui-ci deviennent des indispensables du travail quotidien.
Cifali (p. 10) nous le rappelle en ces termes : « Œuvrer en tant que sujet éthique serait la tâche d’un professionnel en relation avec un autre. Elle requiert des qualifications qui ne sont pas acquises une fois pour toutes, comme un savoir que l’on ne perdrait jamais. Ce sont des qualifications humaines qui sculptent notre vie, comme notre travail, constamment à retrouver et reconstruire suivant telle ou telle rencontre, telle ou telle confrontation, tel ou tel dispositif. » Un lien doit être autre chose qu’un poncif que l’on agite pour se donner bonne conscience. En faire le tour, décrire ses travers comme ses forces, nous permet de ne pas le réduire à un décret vide ou à un kit prêt-à-travailler bon marché.
Cifali s’est attelée à cette tâche en reprenant des écrits, des conférences qui ont jalonné son parcours de psychanalyste et de professeure à l’Université de Genève. De nombreux auteur·e·s sont convié·e·s et enrichissent la réflexion.
La relation à l’autre se travaille et elle est également travaillée en retour par cet·te autre. La lecture de ce livre permet de se pencher sur ces « manières d’être professionnellement, dans un rapport à soi, à l’autre, à d’autres, au monde » (p. 10). Penser la relation à partir de soi certes, mais aussi à partir de l’autre et de ce qu’il peut (r)éveiller en nous. Ceci sans oublier le contexte au sens plus ou moins large dans lequel on intervient (équipe, institution, pédagogies ou techniques diverses, voire même politiques sociales).
Affirmer exercer un métier dans un terrain neutre est un leurre, une objectivité pure et dure n’existe pas.
Chaque professionnel·le aurait à « (…) chercher comment s’articulent la relation (pour qu’elle ne se détruise pas), le lien (pour qu’il se construise à deux) et la rencontre (pour qu’elle se transforme, les trois si précieux à nos vies humaines et professionnelles » (p. 15).
Pour donner une idée plus précise du contenu de l’ouvrage construit en trois parties, je vais énoncer les titres généraux des chapitres les composant. Je reprendrai pour chacun d’eux quelques éléments marquants selon mon point de vue.
Partie I : « L’hospitalité d’un lien »
Chapitre 1 : « Penser en relation »
Je retiens ici cette idée de tensions, de contradictions parce que « Etre en relation, c’est conjuguer un “entre” » (p. 29). Entre ce que cette personne pense et ce que je pense, entre ce que je veux pour elle et ce qu’elle estime bien pour elle, entre ce que je défends et ce que l’autre pense juste, etc. Le lien présuppose le rapprochement, mais il ouvre également sur de la distance, il la permet. Il n’est pas usuel de penser ainsi.
Un autre aspect inhabituel est rapporté : celui de se méfier de l’adage courant qui dit qu’il faut mettre l’autre au centre. Pour l’auteure, il s’agit plutôt de le soutenir « dans sa capacité d’être un sujet agissant, même et surtout si cette capacité a été mise à mal. On évitera de vouloir le mettre “au centre” : il n’a pas à l’être au centre, il est l’un des termes, certes celui qui rend possible, ou pas, la construction d’un lien. Pas objet de soin, mais sujet dans le soin ; pas objet seulement d’enseignement, mais sujet en désir d’apprendre. Pas objet d’une contrainte à penser, mais sujet développant sa pensée avec l’appui d’auteurs. Pas une victime, mais un être agissant malgré les difficultés rencontrées » (p. 36).
Accorder à l’autre une place de vraie personne partie prenante de la situation, même si elle la fait échouer selon nos critères. La placer au centre, c’est peut-être ne pas lui laisser la possibilité d’être ailleurs, en retrait, dans un coin plus sombre.
Chapitre 2 : « Apprivoiser une difficulté »
Des difficultés, nous en rencontrons dans le champ de la petite enfance. Enfants rebelles, familles compliquées, équipes tendues, etc. Pour les un·e·s comme pour les autres, « apprendre et grandir ne se réalisent pas sans difficulté et sans confrontation et angoisse » (p. 48), nous rappelle Cifali. Alors, il faut un peu « triturer » notre rapport à la difficulté, la nôtre comme celle de l’autre, car elles ne sont généralement pas les mêmes. De plus, les problèmes identifiés font souvent référence à certaines normes, mais de quelles normes parlons-nous ?[2]
Il est aussi intéressant de savoir que de ces difficultés diverses, chacun·e peut en « ressortir » grandi·e. Cependant, en tant qu’éduc, enseignant·e ou soignant·e, il reste à être attentif/ve à cet·te autre : « Le problème éthique existe de savoir ce que nous faisons de sa souffrance, et si nous avons le droit de nous enrichir de ses épreuves » (p. 59).
Chapitre 3 : « Apprendre de et pour soi »
Un « savoir sur » n’y suffit pas pour être un·e bon·ne professionnel·le. Il s’agit de construire aussi un « savoir de ». Avoir des connaissances étendues, maîtriser des techniques, ne dit rien de comment nous allons savoir agir en situation. Que savons-nous de nos butées, de nos angoisses, de nos énigmes qui surgissent parfois au moment où l’on s’y attend le moins ? Sans entreprendre forcément un long « travail psy », il est important de faire quelque chose de ce que l’expérience nous enseigne. L’aléa, l’imprévu sont souvent au rendez-vous. Sommes-nous capables d’y faire face ? Il faut se donner les moyens de faire un vrai travail pour ne pas reproduire sans fin les mêmes erreurs. Etre attentif/ve à soi et à ses travers n’est pas de l’ordre de l’évidence, mais il est parfois plus facile de s’inquiéter des travers de l’autre.
Chapitre 4 : « Affronter les contrecoups »
Cifali choisit de reparcourir ses fidélités (à des auteurs, à des disciplines et à sa posture de clinicienne) pour mieux les mettre en miroir avec des théories actuelles (très prisées comme le management, la PNL, l’analyse transactionnelle, l’intelligence émotionnelle) mais qui, en utilisant presque le même vocabulaire, distordent le propos, dénaturent le travail tel qu’il a été pensé préalablement. Avec de réels dérapages dont le sujet fait les frais : « Les mots confiance en soi, affirmation de soi, maîtrise de soi, ingénierie de soi, gestion de soi, etc., montrent que le soi est devenu un objet que l’on peut maîtriser (…). Le soi y est a-conflictuel (…) il porte la responsabilité de ses actes, qu’ils soient de réussite ou d’échec. (…) Avec une telle sur-psychologisation du sujet, on gomme le fait qu’un sujet est une fabrication sociale, influencé par les circonstances » (p. 93). Avec un vrai danger de faire croire à toutes et à tous que l’on peut sans problème maîtriser son propre destin mais également que l’on peut maîtriser l’autre. Cela ressemble étrangement et trop souvent à des techniques manipulatoires…
Cette phrase résume bien les dangers qui nous guettent : « Les convictions que nous avons ne sont jamais bonnes en elles-mêmes, il s’agit sans cesse de les relier aux conséquences des actes que nous posons dans une situation singulière » (p. 96).
Partie II : « Une intériorité préservée »
Chapitre 1 : « Agir et ressentir »
Faire une place à la subjectivité n’est pas nouveau. Pourtant, il me paraît d’autant plus sensé de le relever quand, trop fréquemment actuellement, tout doit être quantifié, rationalisé, objectivé. Cela au détriment des professionnel·le·s qui agissent comme au désavantage des personnes dont ils/elles s’occupent. A nouveau, il ne s’agit pas de défendre la subjectivité pour la subjectivité, mais de savoir qu’elle est présente, qu’elle oriente nos actions et qu’il est primordial de la travailler, de l’assumer.
Dans ce chapitre, la place des sentiments est interrogée et non bannie.
Chapitre 2 : « Se dégager d’un pessimisme »
Exercer un métier parce que l’on veut venir en aide à son prochain est perçu comme positif, cependant Cifali nous met en garde (avec raison, je pense) que « l’aide n’est pas qu’altruiste, qu’on aide parfois davantage pour se sentir exister que pour le bénéfice d’un autre » (p. 154). Cela lui a d’ailleurs été beaucoup reproché. Elle tente pourtant juste de rendre vigilant·e·s les professionnel·le·s que, par exemple, l’amour n’existe pas sans la haine, que les contraires sont « (…) à maintenir ensemble. Exclure le terme dit “négatif” ne l’empêche pas d’exister. Ce serait davantage en reconnaissant ce supposé “négatif” que le supposé “positif” advient » (p. 152). La négativité est des fois bien réelle, il ne faut pas l’effacer, mais en tenir compte et la mettre sur l’établi.
Chapitre 3 : « Continuer à parler de sentiments »
Différencier les sentiments des émotions et surtout en dire quelque chose de bien construit est bienvenu à l’heure où ces dernières prennent tant et tant de place dans toutes les bouches et dans tous les médias. Autoriser les affects bien sûr, mais interroger la toute-maîtrise des émotions et avoir un regard critique sur les neurosciences. Ce chapitre me paraît d’actualité.
Partie III : « Une éthique relationnelle »
Chapitre 1 : « Accepter l’interminable »
Un bref détour par l’histoire de ce qu’on nomme « les trois métiers impossibles » (gouverner, soigner, éduquer) permet d’approcher notre rapport à l’impuissance – tout ce que l’on fait ne sert à rien, on ne va jamais y arriver, c’est impossible – comme notre rapport à la puissance. Parler de succès insuffisant dans le travail n’est pas la même chose que de parler d’échec. Nous ne sommes pas loin de la mère suffisamment bonne de Winnicott.
D’un autre côté, du côté de la toute-puissance, il est indispensable de s’attarder sur le pouvoir (bien réel dans certaines situations) ou du moins sur la notion de pouvoir qui entoure ces professions. D’autant plus peut-être que l’autorité vole en éclats ou semble être dans tous ses états.
Chapitre 2 : « Construire des repères »
Pour les adeptes des questions morales, déontologiques, ce chapitre ravive les notions et nous encourage sûrement à revisiter nos certitudes entre éthique de la conviction, éthique de la responsabilité et éthique de la finitude. Les partitions sont d’ailleurs souvent plurielles, mais savoir mieux où chacune d’entre elles nous amène n’est pas inutile.
La technique c’est bien, trop de technique tue… pourrais-je aussi dire sur ce chapitre.
Chapitre 3 : « Reconnaître l’inacceptable »
Etre conscient·e·s que, parfois, « Quand nous sommes pris dans un rôle et une institution, des gestes nous paraissant aberrants quand on les voit en extériorité nous viennent néanmoins. Nous ne sentons plus la portée de nos actes qui peuvent alors s’avérer d’une grande violence ; nous bafouons la dignité d’un humain sans nous en rendre compte » (p. 275). Réfléchir, se battre pour réussir à garder de bonnes conditions d’exercice du métier, pour penser notre travail et ne pas se laisser emporter dans une malfaisance institutionnelle, est un minimum.
Chapitre 4 : « Transmettre une énigme »
Rétrospective d’un parcours de professeure d’université, retour sur une pensée plurielle, mise à plat de mises en œuvre de disciplines diverses ?
Je ne sais pas trop.
Ce que je sais, c’est que cet ouvrage peut se lire de manière disparate : d’une traite et à la suite pour les inconditonnel·le·s de Mireille, par thématique pour les lecteurs et les lectrices qui cherchent des réponses à certaines questions (ils, elles ne les trouveront pas, mais ils et elles auront la possibilité de (re)considérer et d’approfondir leurs interrogations) ; de manière très ciblée pour enrichir colloques et entretiens étudiant·e·s/apprenti·e·s ; ou comme somnifère pour ceux et celles qui ont arrêté de penser, de chercher.
Karina Kühni
[1]-Cifali, Mireille (2019), Préserver un lien, Puf, Paris.
[2]-Voir Revue [petite] enfance N° 132.
![Revue [petite] enfance](https://revuepetiteenfance.ch/wp-content/uploads/2022/12/revue_petite_enfance-302x103.png)