La précarité est plus répandue et plus proche de nous qu’on le croit. Dans le monde, en Suisse, et jusque dans « nos » garderies, crèches ou jardins d’enfants.
Ces vignettes confèrent une existence palpable, vécue et ressentie de différentes formes de précarité rencontrées par de vraies personnes qui travaillent sur le devant de la scène.
Notre envie était de donner une voix aux professionnel·les qui côtoient de près des familles dans la pauvreté, le dénuement, le manque de ressources diverses. A travers leur voix, nous espérions mettre en lumière une réalité trop souvent occultée et ainsi dévoiler la diversité, comme parfois l’ampleur, des problèmes croisés. Nous souhaitions aussi pointer les effets du vécu de ces personnes précaires. Par ricochet, c’était pour nous une manière de faire entendre une autre voix, celle des démunis. Pari réussi.
L’idée de reprendre ce concept de voix s’est imposée comme une évidence. Il est repris des textes de Gilligan (2009) et d’un article de Molinier (2015) qui montrent bien comment une voix n’est pas égale à une autre, le contexte dans lequel elle est énoncée « favorise » plus ou moins son écoute. « Or Gilligan situe la voix – le sujet – dans un faisceau de relations, indissociable de son environnement proximal. Une voix, c’est l’incarnation d’un corps “relationné”, en quête d’expression. L’insistance sur “la disposition à écouter” est alors capitale, une voix est entendue ou elle ne l’est pas. Ainsi, le tribunal rabbinique est fait pour écouter la voix du mari, non celle de l’épouse. L’assemblée nationale a été pensée pour faire résonner avantageusement les tribuns. Ce qui compte n’est plus une intériorité psychologique autodéfinie, mais l’expression du sujet – dont le destin devient indissociable de sa réception, de qui l’écoute. A la question de “Qui suis-je ?” doit s’ajouter, voire se substituer “Qui m’entend ?” »[1]
A travers une dizaine de vignettes, nous avons pu repérer diverses problématiques rencontrées, nous avons pu mettre en évidence ce qui se fait dans les institutions, mais aussi, ce qui encore trop souvent s’interrompt, voire ne se fait pas.
Les exemples moissonnés sont doublement intéressants.
Du côté des familles
Tout d’abord, nous tenons à souligner que chaque vignette donne à voir et à comprendre les multiples difficultés et les obstacles vécus par chacune de ces familles :
Au-delà de la confrontation à des réalités économiques difficiles, des réalités culturelles ou plus sociales viennent également dégrader les situations.
ATD Quart Monde[2] parle « de pauvreté monétaire et de pauvreté “en conditions de vie” » : les vignettes mettent bien le doigt sur ce dernier point.
Chaque histoire met également en évidence que, dans l’adversité, la voix des un·es n’est pas égale à la voix des autres. Que ce soit parce qu’il est atteint d’une maladie psychique, que ce soit parce qu’elle ne paie pas ses factures, que ce soit parce qu’ils viennent d’ailleurs et qu’ils n’ont qu’à comprendre les règles d’ici. L’air du temps renvoie assez systématiquement les gens à leur responsabilité individuelle et élude ainsi les responsabilités institutionnelles.
Les vignettes montrent des professionnel·les qui ont su « entendre » les difficultés des familles, des enfants – donc leur voix – parfois ténue ou inexistante. Chacun·e, à sa manière, a tenté d’améliorer la situation : en donnant de sa personne, en contournant les règles ou en tentant de les expliciter, en aménageant des horaires ou en étant simplement à l’écoute. Nous tenons toutefois à mentionner que toutes et tous les professionnel·les ne sont pas forcément sensibles à ces formes de précarité et que toutes et tous ne se battent pas pour faire entendre la voix des moins bien loti·es.
Certain·es posent tout de même de toutes petites pierres à l’édifice d’une justice qui pourrait être plus redistributive, plus solidaire, plus juste.

Pourtant, même les plus attentionné·es se sont retrouvé·es, à un moment donné, piégé·es par des barrières plus ou moins invisibles mais tellement efficaces : les lois diverses concernant l’immigration ou le chômage, les barrières administratives des institutions, les conséquences des séparations de couples, avec bien sûr toujours en filigrane la pression du chiffre (fréquentation/occupation des places disponibles dans les institutions). Pression « qui a colonisé aussi bien la production industrielle que l’élevage, l’agriculture, les activités privées et publiques » (Dejours, 2022[3]).
Pourquoi les professionnel·les ont-ils·elles tant de peine à faire entendre leur propre voix quand il s’agit de relayer des injustices constatées sur le terrain au niveau politique ? Parce que les lois et les règlements divers concernant les familles et leurs enfants se soucient plus d’une logique comptable et administrative que d’un vrai soutien aux plus fragiles.
Certaines fois ces familles semblent considérées comme des variables d’ajustement pour atteindre une fréquentation maximale des lieux d’accueil ; en contradiction massive avec le discours ambiant qui prétend mettre l’enfant au centre, qui encense l’encouragement précoce, qui vante l’égalité des chances, etc.
Nous devons encore ajouter à cette liste un autre barrage : les propres représentations de chacun·e qui enferment et condamnent parfois des familles déjà en grande difficulté. Les codes en vigueur en Suisse ne sont pas des codes totaux et ils doivent être réinterrogés à la lumière des vécus singuliers.
Du côté des professionnel·les
Beaucoup de vignettes rendent compte de décisions avec lesquelles les professionnel·les ne sont pas en accord parce qu’elles malmènent encore plus des personnes déjà dans une immense galère. Des progrès sont réalisés auprès des enfants, auprès des parents puis, souvent sous couvert de raisons administratives, tout part en fumée. Il y a là une vraie négation du travail éducatif.
Apostille
Il ne s’agit pas, dans ce qui suit, de minimiser ce que vivent ces familles maltraitées ou de comparer des situations qui n’ont pas à l’être ; cependant, nous ne pouvons faire l’impasse des incidences de la réalité de leur vécu sur le travail des professionnel·les.
Comment trouver du plaisir à faire son travail quand ce qui est entrepris est systématiquement déprécié, dévalorisé, voire carrément pas pris en compte ? Chacun·e se cache derrière la décision des autres.
Dejours (ibid.), dans un récent article, reprend les composantes complexes du plaisir au travail et explicite les trois niveaux de sublimation qui concourent à aimer faire son travail. Trop rapidement nous résumons son propos :
Le niveau poiétique de la sublimation : au travail, le réel résiste, le·la professionnel·le n’arrive pas immédiatement à réaliser sa tâche, il y a dans un premier temps « souffrance ». Mais quand le·la travailleur·euse s’échine et qu’il·elle trouve une solution à la difficulté, alors cela se transforme en plaisir.
Que devient ce plaisir quand, par une décision politique ou économique, le travail éducatif effectué est annulé ?
Le niveau déontique de la sublimation : c’est la reconnaissance par les pair·es du travail exécuté selon les règles de métier, avec le petit plus d’une touche personnelle. C’est aussi la reconnaissance d’un bon travail par les bénéficiaires et la hiérarchie.
Que devient le plaisir quand on annonce aux familles que, non, elles ne pourront plus venir à la garderie ?
Le niveau sociétal de la sublimation : ce niveau est particulièrement mis à mal dans les vignettes recueillies puisqu’il est « électivement associé à la prise en considération des incidences de son travail sur l’autre. Non seulement l’autre à l’intérieur de l’entreprise ou de l’institution, mais l’autre, à l’extérieur. Tout travail, sans exception, a des incidences directes ou indirectes sur l’autre externe. (…) La valeur du service ne dépend pas que du prestataire, mais aussi du bénéficiaire du service. Car la qualité dépend de la capacité du bénéficiaire de comprendre le service qu’on lui propose, de l’accepter, de se familiariser avec ces particularités et de l’utiliser ». (Ibid.)
Où est le plaisir quand la confiance tissée au fil des jours est mise à mal par des décisions arbitraires et/ou favorisant systématiquement les nanti·es ?
Les liens sont forts entre plaisir (au travail) et santé. Les vignettes relatées montrent bien que, parfois, les conditions ne sont vraiment pas remplies pour avoir des raisons d’être heureux·euses au travail.
[1]-Molinier, Pascale (2015), « Des différences dans les voix différentes », Recherches féministes (2015), vol. 28 N°1, pp. 45-60.
[2]-ATD Quart Monde (2015), En finir avec les idées fausses sur les pauvres et sur la pauvreté, Ed. Quart Monde et Ed. de l’Atelier, Paris, pp. 31-44.
[3]-Dejours, Christophe (2022), « Conditions d’accès au plaisir dans le travail », Travailler N° 48.

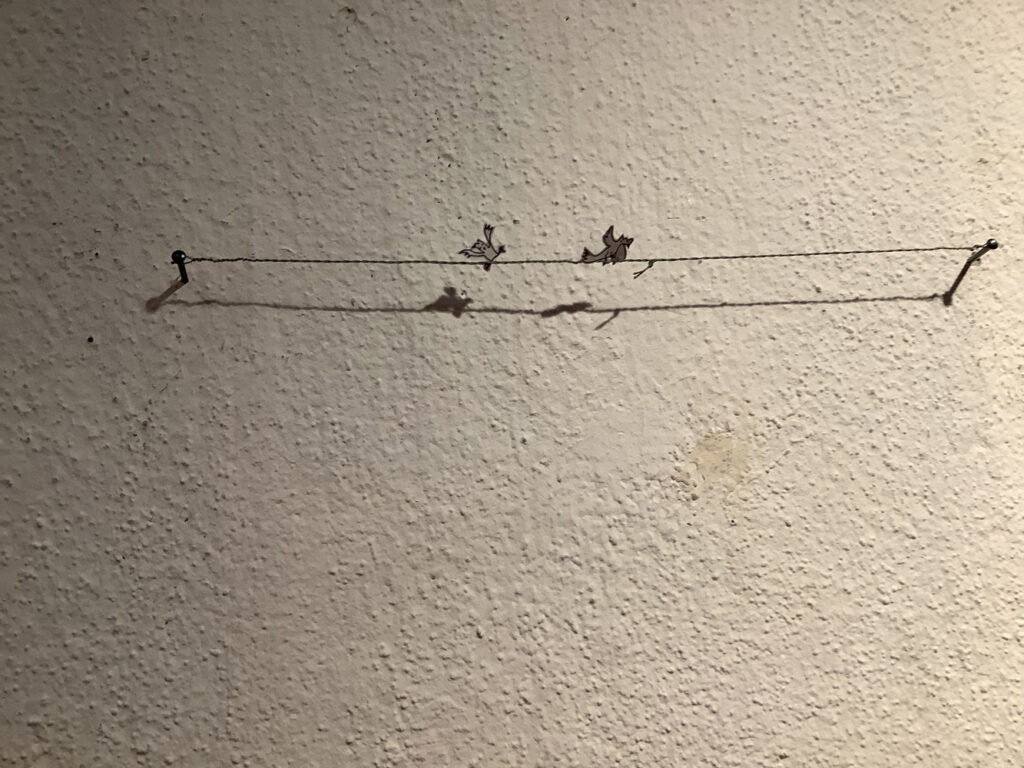
![Revue [petite] enfance](https://revuepetiteenfance.ch/wp-content/uploads/2022/12/revue_petite_enfance-302x103.png)